
Chaque 1er avril, les réseaux sociaux s’animent de blagues en tout genre. On crie au “poisson d’avril”, sans vraiment savoir pourquoi. On imprime un poisson, on le colle dans le dos d’un camarade, on envoie des messages absurdes pour “piéger” les gens. On s’amuse, oui, mais surtout… on copie.
Comme bien d’autres traditions, celle-ci vient d’ailleurs. Elle s’est installée chez nous sans faire trop de bruit. On l’a adoptée sans poser de questions. Et nous voilà chaque année à rejouer un scénario hérité d’une vieille réforme de calendrier français, sans jamais se demander : “Mais à quoi ça sert ? Qu’est-ce que cela dit de nous ?”
Ce phénomène dépasse largement le 1er avril. Il touche notre perception du monde. On reprend tout ce que les autres font, sans prendre le temps de comprendre l’origine, le sens profond, ou les implications culturelles. Pire encore : on finit par abandonner ce que nous avons nous-mêmes de plus précieux.
Copier, ce n’est pas s’approprier. Copier, ce n’est pas créer.
Ce mimétisme permanent a un coût. Un coût identitaire. Un coût culturel. Pendant qu’on s’affaire à reproduire ce qui brille ailleurs, nos propres richesses tombent dans l’oubli. Nos récits, nos proverbes, nos rythmes, nos fêtes, nos rites… Qui les connaît encore réellement ? Qui les valorise ? Qui les transmet ?
On croit être “connectés au monde”, alors qu’on se déconnecte de nous-mêmes.
On croit “être modernes”, alors qu’on devient invisibles.
Et si on changeait de perspective ?
Et si, au lieu de copier sans comprendre, on prenait le temps de réapprendre notre propre culture ?
Et si, au lieu de courir après des tendances extérieures, on faisait le pari de mettre en lumière ce que nous avons d’unique ?
Et si, demain, ce n’était plus nous qui copions, mais le monde entier qui s’inspire de nous ?
On aime dire que le monde est un village. Très bien. Mais alors il est temps que notre village y ait une vraie place.

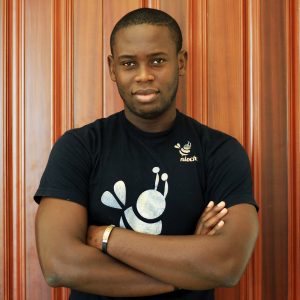


No Comment! Be the first one.